Publications et ressources
Vous trouverez ici une variété d'articles, d'études et de publications sur la ZLECAf qui ont été publiés dans le cadre du projet ou par nos partenaires.
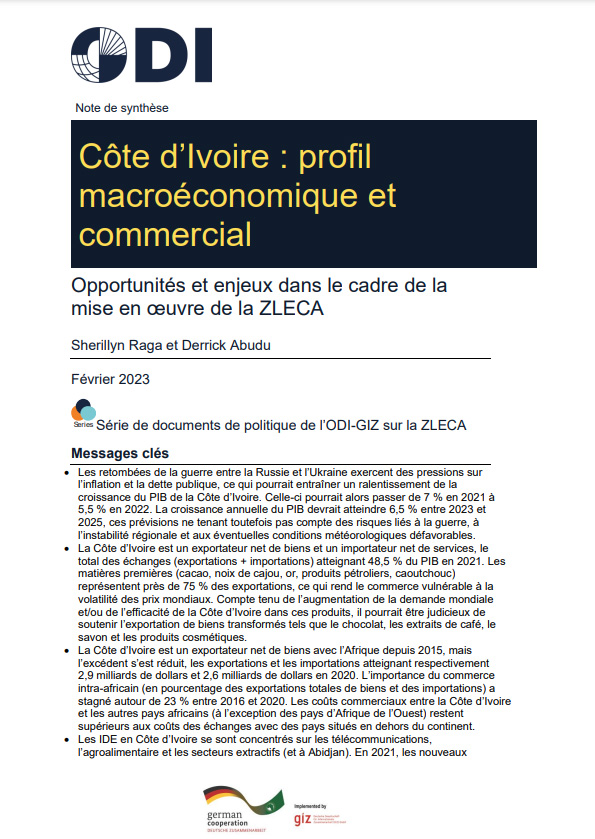
2024
Côte d’Ivoire : profil macroéconomique et commercial
Depuis la fin de crise politique en 2011, la Côte d’Ivoire est devenue l’un des pays à la croissance économique la plus rapide du monde avec, entre 2012 et 2019, une croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) de 8,2 %.1 La Société financière internationale (SFI) a mis en évidence cinq éléments clés qui ont contribué à cette croissance soutenue : l’accélération des investissements publics ; la forte production et la diversification des exportations agricoles ; l’augmentation des investissements directs étrangers (IDE) ; l’amélioration de l’accès aux services numériques ; et
l’amélioration de l’accès à l’électricité à bas prix (avec toutefois des perturbations de fin 2020 à août 2021) (SFI, 2020).2 La pauvreté, l’emploi et le revenu par habitant, qui avaient connu une dégradation au plus fort de la crise politique fin 2010, ont enregistré une amélioration considérable durant la période post-conflit
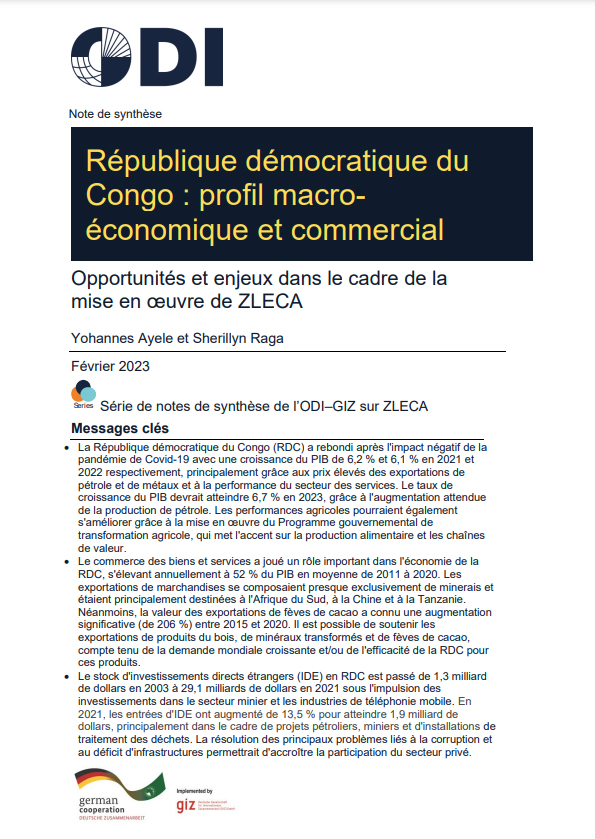
2024
République démocratique du Congo : profil macroéconomique et commercial
La RDC est le plus grand pays d’Afrique subsaharienne par sa superficie et jouit d’une position stratégique, partageant une frontière commune avec neuf pays.1 Le pays est doté de ressources naturelles, notamment : des minéraux tels que le cobalt, le cuivre, l’étain et le tungstène ; un potentiel hydroélectrique ; des terres arables ; une population jeune et nombreuse ; et une immense biodiversité (Banque mondiale, 2022a).
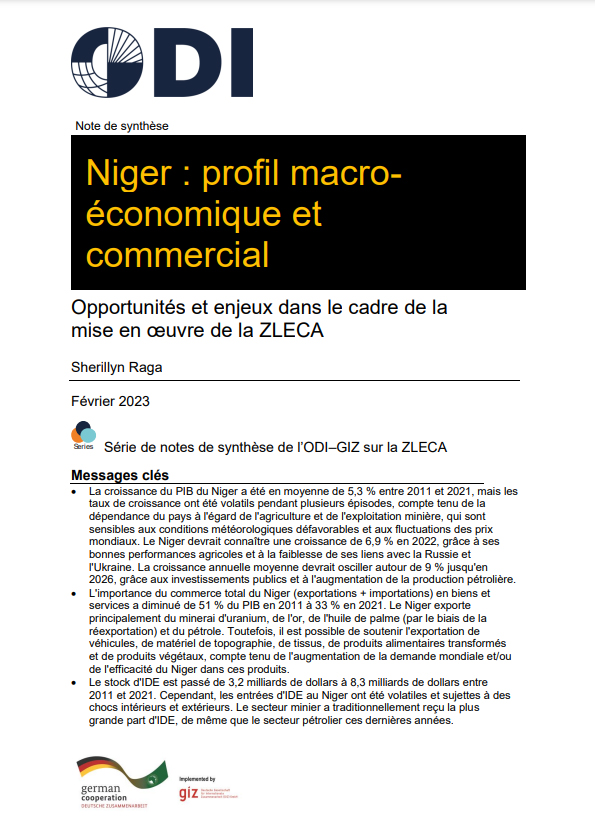
2024
Niger : profil macroéconomique et commercial
Le Niger est un pays enclavé d\'Afrique de l\'Ouest, parmi les moins développés. C\'est aussi l\'une des nations les plus pauvres du monde, avec un niveau de développement humain parmi les plus bas (Tableau 1).1 On estime que la moitié de ses 25 millions d\'habitants vivait dans la pauvreté (moins de 2,15 dollars par jour) en 2021 (Banque mondiale, 2022a). Avec une grande partie de son territoire couvert par le désert du Sahara, le Niger est extrêmement sensible aux invasions de criquets, aux sécheresses récurrentes et à la désertification progressive (Pinto Moreira et Bayraktar, 2005). Plus de 75 % de la main-d\'œuvre travaille dans l\'agriculture de subsistance et est exposée aux effets néfastes du changement
climatique (Banque mondiale, 2022a ; 2022b). La production du Niger étant largement tributaire de l\'agriculture et des activités minières, la croissance économique est vulnérable aux chocs climatiques et à la demande extérieure. Dans ce contexte, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a été volatile, allant de 2,4 % à 10,5 % entre 2011 et 2020.
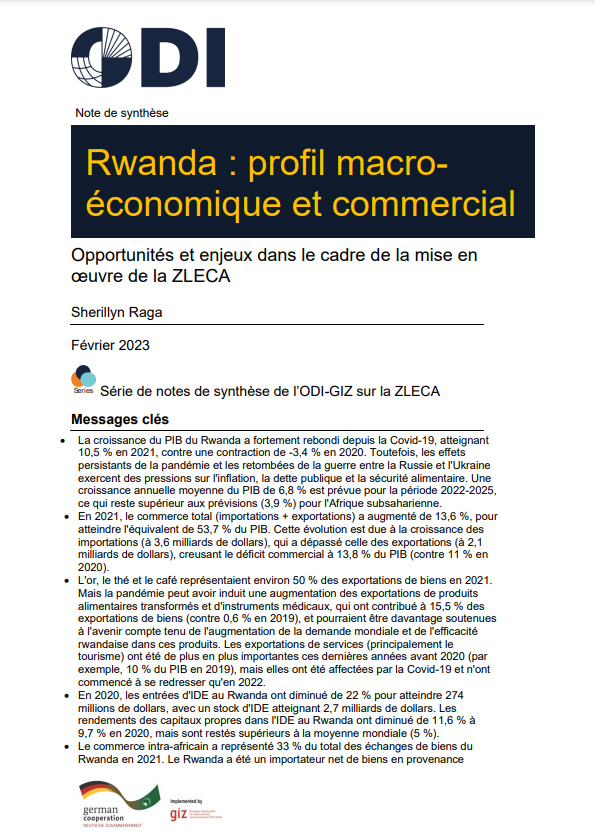
2024
Rwanda : profil macroéconomique et commercial
Le Rwanda a réalisé d’importants progrès en matière de développement
économique et social depuis le génocide et la guerre civile de 1994 (Tableau 1). La pandémie de Covid-19 a toutefois gravement affecté le tourisme, les services et les activités industrielles du pays, entraînant une baisse du produit intérieur brut (PIB) de 3,4 % en 2020 (FMI, 2021a). En 2021, le PIB a fortement rebondi, avec une croissance de 10,9 % (au même niveau que la croissance prépandémique de 9,5 % en 2019), soutenue par l\'accélération de la vaccination, la levée des restrictions, la reprise de la demande extérieure pour les exportations rwandaises et les politiques
accommodantes (FMI, 2022a). Les dépenses annoncées par le Rwanda dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ont atteint 1 milliard de dollars (10,1 % du PIB), ce qui est supérieur aux paquets des pays à faible revenu (4 % du PIB) et proche de ceux des marchés émergents (9,9 % du PIB).1 En août 2021, le Rwanda a levé 620 millions de dollars grâce à l\'émission d\'euro-obligations à 10 ans pour financer la reprise post-pandémie, refinancer la dette arrivant à échéance en 2023 et financer des investissements stratégiques (MINECOFIN, 2021). Le programme
budgétaire spécial Covid-19 du Rwanda a été évalué comme ayant limité l\'impact de la crise (FMI, 2021b), mais a pu contribuer à une augmentation significative de la dette publique et de l\'inflation, qui est restée élevée en 2021.
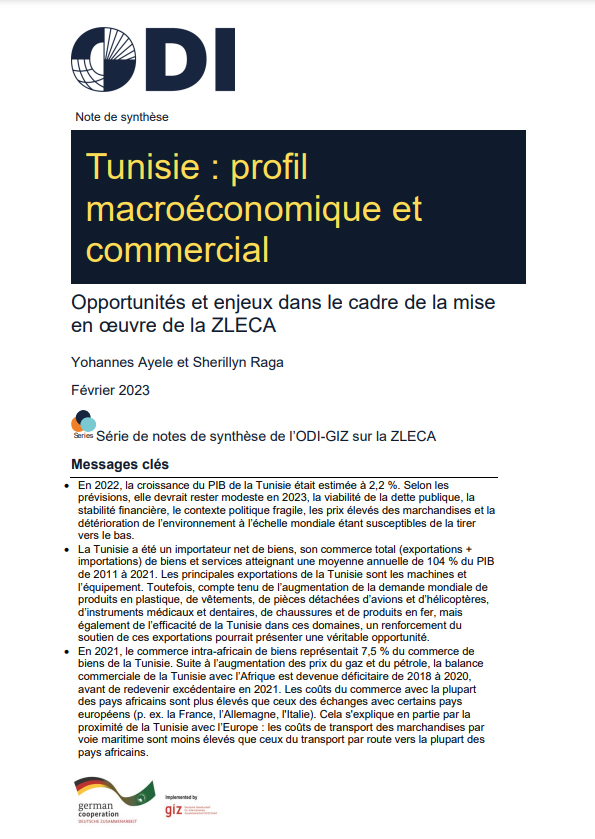
2024
Tunisie : profil macroéconomique et commercial
Plus d’une décennie après la révolution tunisienne de 2011, le pays reste confronté à un environnement politique fragile et n’a pas encore récolté les fruits économiques de ses efforts en faveur de la transition démocratique. De 2012 à 2019, l’économie tunisienne a enregistré une croissance annuelle moyenne de 2 %, c’est-à-dire inférieure à la croissance annuelle moyenne de 4% enregistrée au cours de la décennie précédant la révolution de 20111 (FMI, 2021b). L’économie tunisienne a été dominée par le secteur des services, lequel représente environ 63 % du produit
intérieur brut (PIB) en moyenne de 2011 à 2019, suivi par l’industrie manufacturière (16,3 %), l’agriculture (10,2 %), l’exploitation minière et les services publics (5,9 %) et la construction (4,6 %).2 Après la révolution, la part des exploitations minières et des services publics dans le PIB a chuté pour atteindre 5,7 % (moyenne de 2012 à 2019) contre 9,6 % durant la décennie précédente (moyenne de 2001 à 2010).3 Alors que la part de la population vivant dans l’extrême pauvreté avec moins de 2,15 $ par jour
(parité de pouvoir d’achat 2017, PPA) est restée inférieure à 1 % (Tableau 1), la part de la population « vulnérable » vivant avec moins de 5,50 $ par jour est passée de 16,7 % à 20,1 %, soit à environ 2,4 millions de personnes en 2020 (Banque mondiale, 2021). Avec un taux de 15,8 %, le chômage est resté élevé durant la dernière décennie (2010 à 2021). Les femmes (23 %) et les jeunes (37 %) sont ici particulièrement touchés, ce qui contribue à alimenter les tensions sociales.
